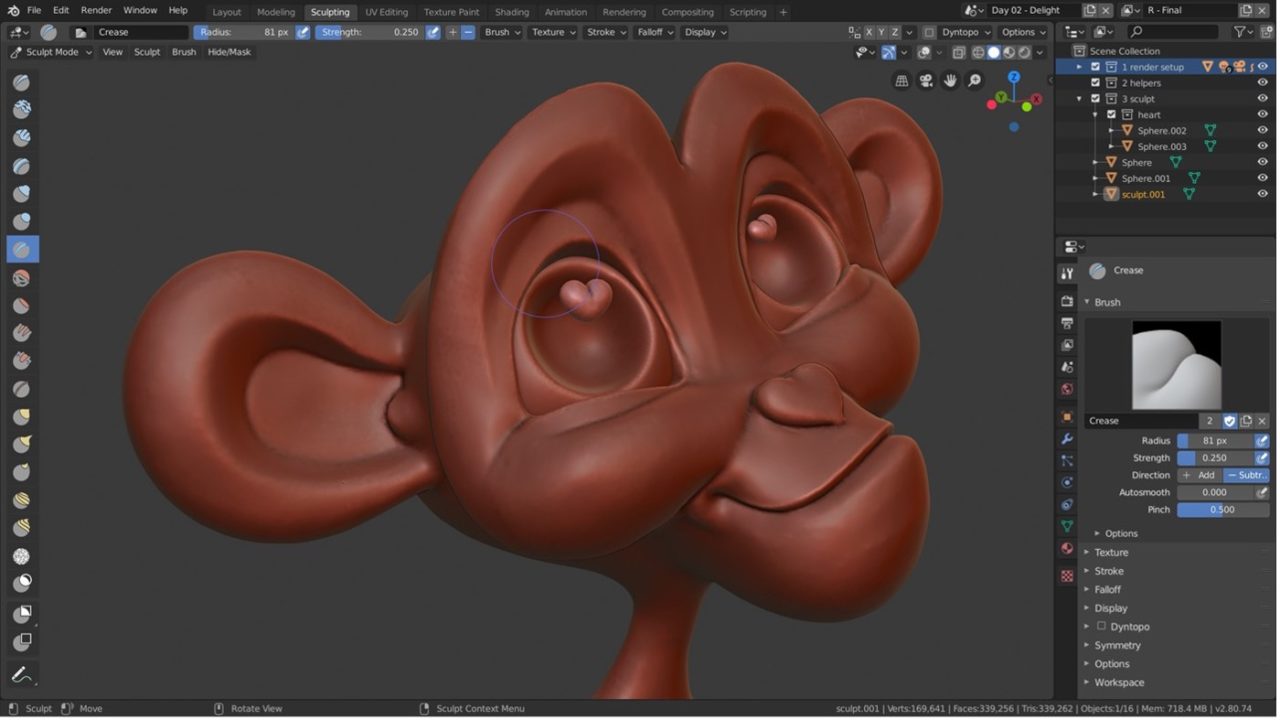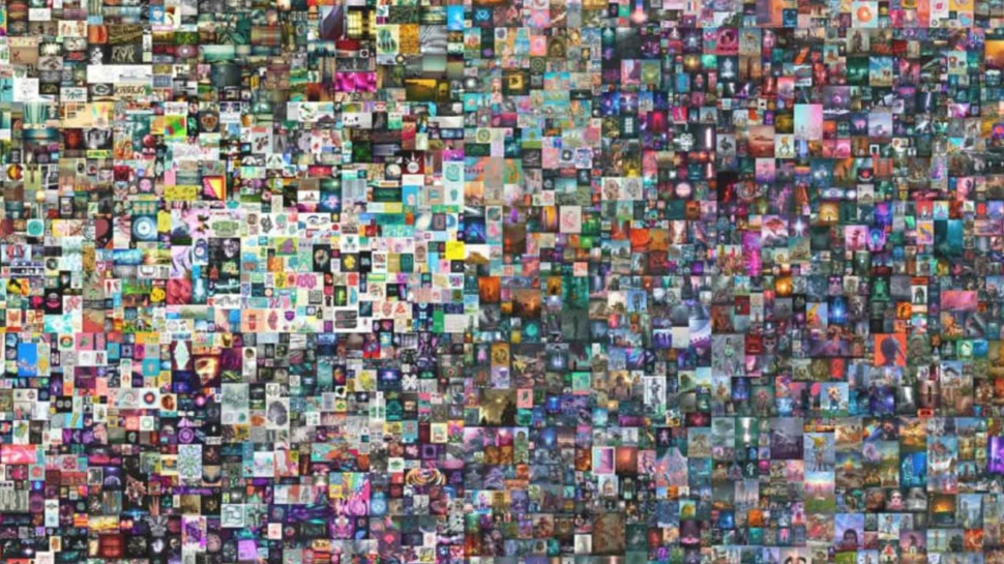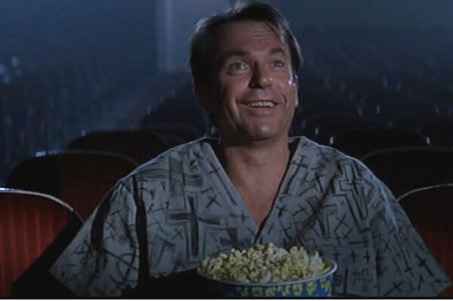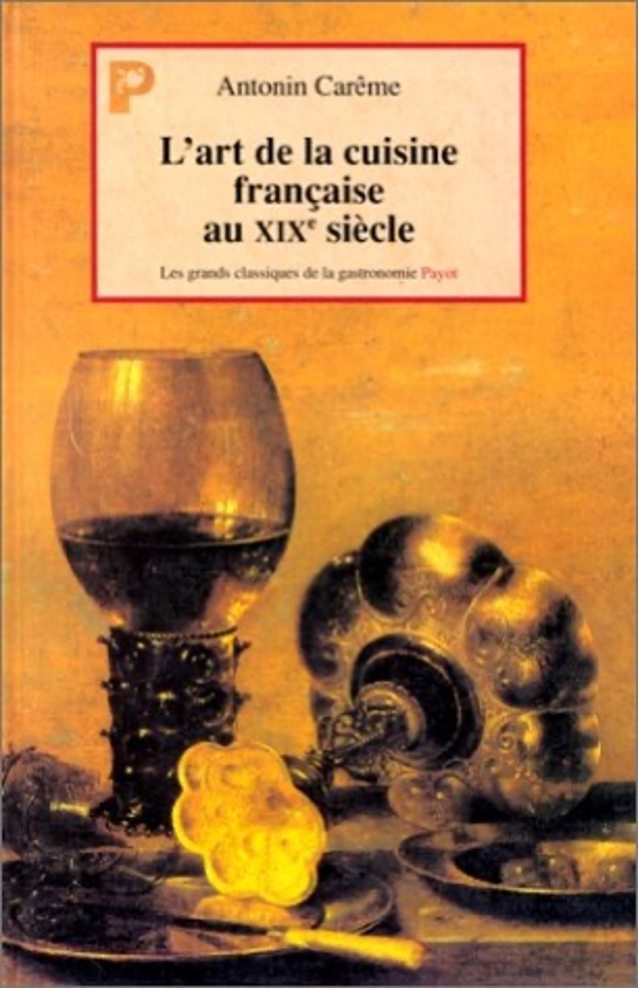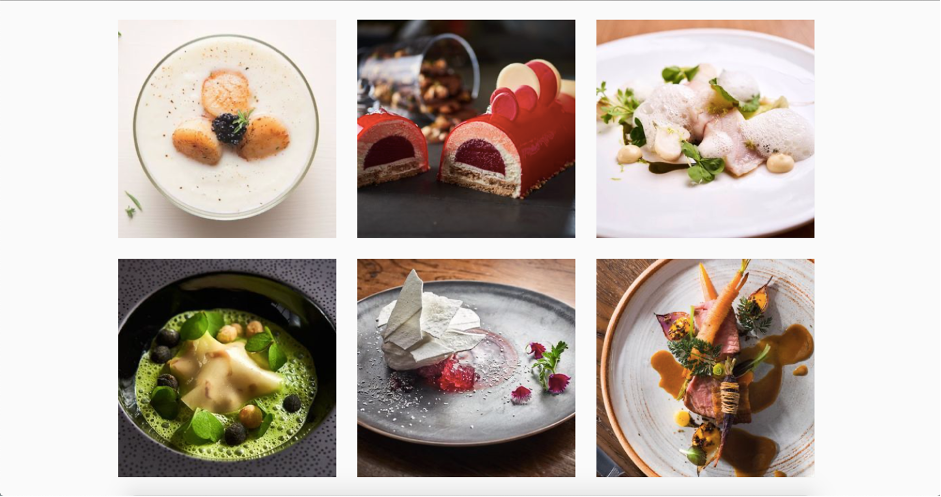« Venez comme vous êtes » et non « pour qui vous êtes »
Savoir accueillir ses publics, est un art que tous les musées cherchent encore à perfectionner. Le fait même de rentrer dans un musée est un acte qui est source de questionnement pour les départements de développement des publics de n’importe quel musée. Les quelques pas qui séparent l’espace public d’un musée font l’objet des premières réflexions sur les dispositifs d’accueil et d’hospitalité
Vous public, soyez les bienvenus
La question de l’hospitalité est fondamentale pour un directeur des publics. L’hospitalité est une histoire de seuil, celui-ci étant une limitation et une frontière. Architecturalement parlant, le seuil du musée est un lieu important. C’est le lieu du franchissement, on change de statut, on passe de personne lambda dans la rue à visiteur, usager. Franchir un seuil est également une forme d’agression, je rentre dans un territoire qui n’est plus le mien mais qui est celui d’un autre. Chez les Grecs, la notion de frontière est conçue soit comme une limite idéale, soit comme une zone floue exploitée par exemple par les citées pour s’agrandir à leur avantage. Ce double sens sémantique est toujours d’actualité dans les métiers des publics.

Avant d’être une notion, l’hospitalité est un acte. C’est ce que le philosophe français Jacques Derrida (1930-2004) appelle l’hospitalité inconditionnelle. Il est d’ailleurs inscrit dans les missions officielles d’un musée d’être le plus accueillant possible et que tout à chacun se sente légitime à rentrer dans un musée. C’est justement en réfléchissant en terme d’acte et non seulement de notion, que les musées seront les plus hospitaliers.
Ce n’est pas par hasard que la prise en compte des publics dans les musées a d’abord pris des formes éducatives. En effet le métier d’enseignant est celui qui met au cœur de ses préoccupations les conditions optimales d’apprentissage et de transmission. Les deux projets fondateurs de l’Ecole du Louvre (1882) éclaire ce lien entre éducation et médiation : elle a été conçue comme une école pratique d’archéologie et d’histoire de l’art, mais aussi une école d’administration des musées, cette école devait former les guides-conférenciers des musée. Ce qui importe à ce moment-là, c’est la relation avec les publics, l’idée de transmission.
Ce n’est pas par hasard que la prise en compte des publics dans les musées a d’abord pris des formes éducatives. En effet le métier d’enseignant est celui qui met au cœur de ses préoccupations les conditions optimales d’apprentissage et de transmission. Les deux projets fondateurs de l’Ecole du Louvre (1882) éclairent ce lien entre éducation et médiation : elle a été conçue comme une école pratique d’archéologie et d’histoire de l’art, mais aussi une école d’administration des musées. Ce qui importe à ce moment-là, ce sont les relations avec les publics, l’idée de transmission.
Le care, du thérapeutique au Musée
Le terme de care n’exprime pas l’acte de soin médical mais plutôt les valeurs qui l’accompagnent. On estime que « prendre soin » de l’autre c’est aussi faciliter la vie d’autrui en accomplissant des gestes quotidiens dans le souci de son bien-être et de son respect.
L’hospitalité d’un musée peut donc être mesurée par l’intégration du confort et bien-être du visiteur dans sa stratégie d’accueil des publics. Au musée des Beaux-Arts de Montréal, la notion du care est très importante. Leur segmentation se fait donc sur des personnes qui ont besoin de soins particuliers comme les handicapés, les personnes âgées, les minorités ethniques, les individus de quartiers défavorisés, etc… Le Canada est le premier pays au monde où un médecin traitant peut traitant peut rédiger une ordonnance pour un quota de visites au musée, plutôt qu’un traitement médicamenteux. C’est ainsi que pour la première fois au monde, un médecin a fait son entrée dans l’équipe d’une institution muséale. Au Musée des Beaux-Arts de Montréal se trouve le Pavillon pour la Paix (photo ci-dessous) où l’art-thérapeute peut recevoir ses patients dans une salle de consultation dédiée.

Trop de public, tue le public ?
Lorsqu’on voit l’attroupement devant un tableau on peut se dire que le musée a réussi son pari de diffusion culturelle mais on peut aussi s’interroger sur les conditions de cette diffusion. C’est alors que la politique des publics fait face à une contradiction : elle est engagée vis-à-vis de son établissement à fabriquer la fréquentation la meilleure possible alors que dans le même temps elle doit réguler cette fréquentation pour ne pas être contre-productif.
La foule est un concept aux connotations négatives (fullarer en latin : fouler, presser) qui indique plutôt une notion de quantité et de multitude indifférenciée. Peut-on penser un ordre de la foule sans la réduire à ce qu’il faut absolument éviter : la désorganisation, la panique, la saturation et donc le déplaisir ? Au contraire, peut-on la concevoir à travers ce qu’elle provoque : un ressenti commun, les liens qu’elle crée, le collectif et le « nous » ? Dans tous les cas la fréquentation entraîne des situations paradoxales. Elle est gage de succès, a un pouvoir d’attraction, mais elle nécessite de fortes régulations, elle engendre des compétences particulières à mobiliser rapidement. Du point de vue des visiteurs, elle engendre des changements dans les stratégies de visite (évitement, réduction de temps, plus de passivité, frustration, fatigue, abandon, etc.).

La médiation culturelle, un art de la relation
La médiation culturelle, si elle est un art de la relation, elle est aussi poreuse à ce qui se joue, non seulement avec les publics qu’elle cible, mais aussi avec la nature des objets qu’elle est supposée accompagner.
Ainsi, selon qu’il s’agisse d’une médiation opérée à l’Opéra, au Théâtre, dans un musée de sciences, de beaux-arts ou encore d’art contemporain ; son approche, ses postures, ses outils pourront évoluer, quand bien même l’on observe de plus en plus une hybridation des formes. On peut alors penser aux manipulations d’objets. On les trouve généralement dans les musées de science où il n’y a pas le support de l’oeuvre d’art. Cela est compensé par des outils souvent inventés pour expliquer un phénomène scientifique qu’ils simulent plus qu’ils ne le montrent. Le conte, le mime, la musique sont aussi des approches qui convoquent le corps, l’écoute, la concentration. On les rencontre à peu près partout et dans tous les types de musées.
Néanmoins il reste important de se poser la question de la légitimité d’une médiation et ne pas orienter sa stratégie qu’en vue d’un rajeunissement de ses publics. Par exemple, est-ce qu’il existe réellement un lien entre le hip-hop et une salle de musée dont les œuvres ne datent pas de la même époque ? Ce type de médiation peut être intéressant, car il permet de rendre le musée vivant, familier, dédramatisé pour certains publics. Mais il faut faire attention à ce que cela ait toujours du sens. Un cours de yoga dans une salle de musée est-il pertinent ? Tout dépend du point de vue, cela peut être le cas.
Il s’agit de ne pas se méprendre sur l’endroit où l’on place le curseur. Selon Serge Chaumier et François Mairesse « Ce qui compte, c’est moins la médiation en elle-même qui devient et demeure un outil, que ce qui est généré pour conduire autre chose. Ainsi peut-on dire que la médiation devient vecteur de quelque chose qui la dépasse ».
La médiation, outil relationnel, reste donc un pilier pour attirer tous les publics et faire en sorte que chacun puisse pousser la porte d’un musée sans se sentir intru ou illégitime.
Muriel Piguet
Sources :
- Bernard Stiegler, Politiques et industries de la culture dans les sociétés hyperindustrialisées, Éditions de l’Attribut, Culture et Société, un lien à recomposer, 2008
- Jacques Derrida « l’hospitalité inconditionnelle »
- « Le public, acteur de la production d’exposition ? Un modèle écartelé entre enthousiasme et réticences », Serge Chaumier
- Dianne Watteau, « Quand l’art prend soin de vous. Les tropismes du care dans l’art aujourd’hui. », numéro 6 de la revue en ligne Plastik. 18/04/2019
- Serge Chaumier. « Le Public, acteur de la production d’exposition ? Un modèle écartelé entre enthousiasme et réticences ». Jacqueline Eidelman, Mélanie Roustan, Bernadette Goldstein. La Place des publics. De l’usage des études et recherches par les musées, La Documentation française, pp 241-250, 2008. ffhal-00454046f
- « Le souci de l’autre, un retour de l’éthique du « care » », Claire Legros dans Le Monde Publié le 01 mai 2020.